50 nuances de mauvaises idées
L’avis du Grill :
Malheureusement pour nous, Luca Guadagnino dissimule dans les murs de l’académie Markos un exercice de style aussi vain que narcissique sous une couche d’idées mal réchauffées qu’il est rigoureusement incapable de développer. Aussi boursouflé que gonflant, son Suspiria atteste qu’il n’est pas le cinéaste qu’il pense être…

Moi après la séance (colorisé, circa 2018)
Avis plus détaillé (qui spoile un peu mais pas trop) :
S’il est inutile d’épiloguer sur la pertinence ou non d’un remake – La mouche et The Thing sont là pour nous prouver que ça peut être une très bonne idée – il faut quand même rappeler que le Suspiria de Dario Argento a sa place au panthéon du culte. Infusé du cinéma de Mario Bava, Argento aurait eu l’idée de son sixième film dans un cauchemar qu’il a décidé de présenter tel quel, en dilatant le temps et l’espace pour suivre la logique diffuse d’un mauvais rêve. Dans une petite ville allemande, une jeune américaine arrive pour rejoindre une école de danse réputée mais cachant un lourd secret. Le pensionnat est un repaire de sorcières gardant leur réserve de petites Gretel à mettre au four. Comme notre héroïne, l’on découvre l’horreur peu à peu en peinant à la saisir dans son ensemble, d’autant que s’il n’a pas pu tourner le film avec des enfants comme il le voulait initialement, il a fait construire les décors 50 % plus grands pour simuler cet écrasement permanent des danseuses par l’institut. Et l’éclairage fou ! Et le sabbat musical de Goblin ! Le film est le chef-d’œuvre du Giallo tout comme de son auteur qui échouera à l’égaler dans le reste de sa filmographie plutôt moribonde (même si L’Oiseau au plumage de Crystal et Les frissons de l’angoisse, c’est le feu).

L’utilisation des miroirs est pas mauvaise en soi, mais comme tout le reste, ça a été mieux fait ailleurs (The Neon Demon par exemple).
Arrive maintenant la version de son compatriote Luca Guadagnino, tout auréolé du succès de Call me by your name (grâce à l’excellent scénario de James Ivory, ses interprètes et le fait qu’il s’est entraîné sur A bigger splash à filmer un paysage méditerranéen). Tourné avec les chevilles plus que sa tête, cette version une heure plus longue que l’originale a au moins le mérite de proposer une réécriture de l’intrigue. Mais voilà ses 7 péchés capitaux (contrairement au titre de l’article, je ne vais pas vous en infliger 50) :
- Exit le cadre de conte de fées, bonjour Berlin-Ouest en plein rideau de fer : L’idée est de présenter le récit de façon réaliste pour que le jaillissement du surnaturel soit, par contraste, encore plus fort. Mais en abandonnant l’onirisme pour un cadre historique précis (les attentats de la bande à Baader sont en arrière-plan avec pléthores d’images d’archives), le film s’embourbe dans un contexte politique qui sert peu ou pas ses thèmes : c’est le bordel hors et dans l’institut ? Ok, et alors ? L’opposition n’a pas lieu et pire, les éléments horrifiques paraissent complètement hors de propos. On touche à l’indécence quand est introduit un survivant de la Shoah dans cette histoire, Suspiria s’alourdit et se dénature en se politisant. Guadagnino n’arrive tout simplement pas à faire quelque chose de son cadre qui a pourtant accueilli des petites choses comme Possession (où le mur se fait le reflet de la schizophrénie de ses personnages) ou Les ailes du désir (qui se sert de la ville déchirée comme microcosme où juger l’humanité).

Le personnage du vieux psychiatre juif est une invention de cette version. Incarné par Tilda Swinton, il phagocyte le récit sans servir à grand-chose.
- Le film abandonne les couleurs chaudes et le style exubérant du Giallo, sauf dans ses affiches/bande-annonce qui du coup deviennent mensongères : Luca Guadagnino a la clarté d’esprit de ne pas essayer de tutoyer la palette démoniaque d’Argento, malheureusement le film alterne tons gris et marrons. Si ce n’est pas mal car ça met en avant les teintes rouges qui s’imposent à mesure que le récit avance, sa volonté d’adopter le style réaliste de Fassbinder est pathétique. En effet, là où le réalisateur de la nouvelle vague allemande radiographiait avec une acuité terrible la lutte entre les classes sociales et mettait en lumière le Berlin underground, ici les emprunts ne sont qu’esthétiques comme une toile de fond réutilisée sans la comprendre. En plus il résume la ville à deux coins de rue filmés comme moi je filmerai Grenoble sous la pluie avec un vieux smartphone cassé.

Luca a fait le choix de n’utiliser ni des danseuses professionnelles (comme dans Climax), ni de coller numériquement la tête de Dakota sur une danseuse pro (comme dans Black Swann), du coup on a des ellipses à chaque fois qu’elle danse et les personnages qui agissent comme s’ils venaient de voir un truc de fou.
- La caméra : Luca reprend tous les gimmicks d’Argento, les zooms en tête, sauf que même Argento n’arrive pas à en faire quelque chose de bien dans la plupart de ses films. Suspiria de 77 étant plus l’exception que la règle. Du coup, t’as parfois l’impression que l’image tressaute comme si le monteur venait de se réveiller en sursaut ou tu ne comprends pas pourquoi il y a des zooms sur des murs décrépis façon vieil épisode de Power Rangers. Bien plus parodique que proche de l’hommage, Guadagnino n’a clairement pas la faculté qu’a par exemple Hazanavicus d’adopter le style de réalisation de l’époque à laquelle se passent ses films. Après, dès qu’il propose des trucs persos, dans les séquences de rêves justement (qui prouvent combien Suspiria est intrinsèquement un pur produit onirique) ou quelques gros plans sur les visages, Guadagnino arrive à capter quelque chose de l’angoisse bizarre que l’on attendait, mais c’est trop fugace que pour être marquant. Dans un autre domaine et à toutes fins utiles, je souhaite ardemment que ses ralentis brûlent dans le cercle de l’enfer dédié aux effets pourris.

Luca Guadagnino a repris le casting d’A bigger splash, il aurait toutefois mieux fait de changer de scénariste.
- Le casting : Chloë Grace Moretz et Mia Goth doivent avoir respectivement trois et douze minutes de présence à l’écran. Tilda Swinton vole le show et Dakota Johnson le massacre. En fait l’héroïne de 50 shades of Grey incarne une Mary-Sue comme j’en ai plus vu depuis Rey dans Star Wars. Elle est l’Elue parfaitement infaillible, pure et surdouée qui gagne immédiatement l’admiration de madame Blanc, le personnage de mère supérieure présentée comme impitoyable et qui va donc se décrédibiliser en quelques minutes. On tombe alors dans un mauvais ressac de porno soft où Tilda Swinton perd toute autorité et se retrouve à bégayer comme une jouvencelle en hésitant pendant 2h à lui parler de sa pleasure room satanique. Si l’héroïne de 1977 était une victime pas follement fouillée mais que l’on suivait dans sa volonté de comprendre et de sauver sa peau, ici l’incarnation du personnage par Dakota Jonson, badass dès la première seconde alors que des flash-backs sont censés nous la vendre comme une oie blanche d’Ohio, se révèle tout à fait inintéressante dans sa trajectoire narrée de façon « arty » mais désespérément linéaire. Là-dedans il y a une vague réflexion sur une relation mère-fille mais bon, comme il s’est senti obligé de rajouter l’holocauste, de la pisse, du tripou et des chevaux qui courent dans l’équation, on va dire que son propos est pour le moins dilué.
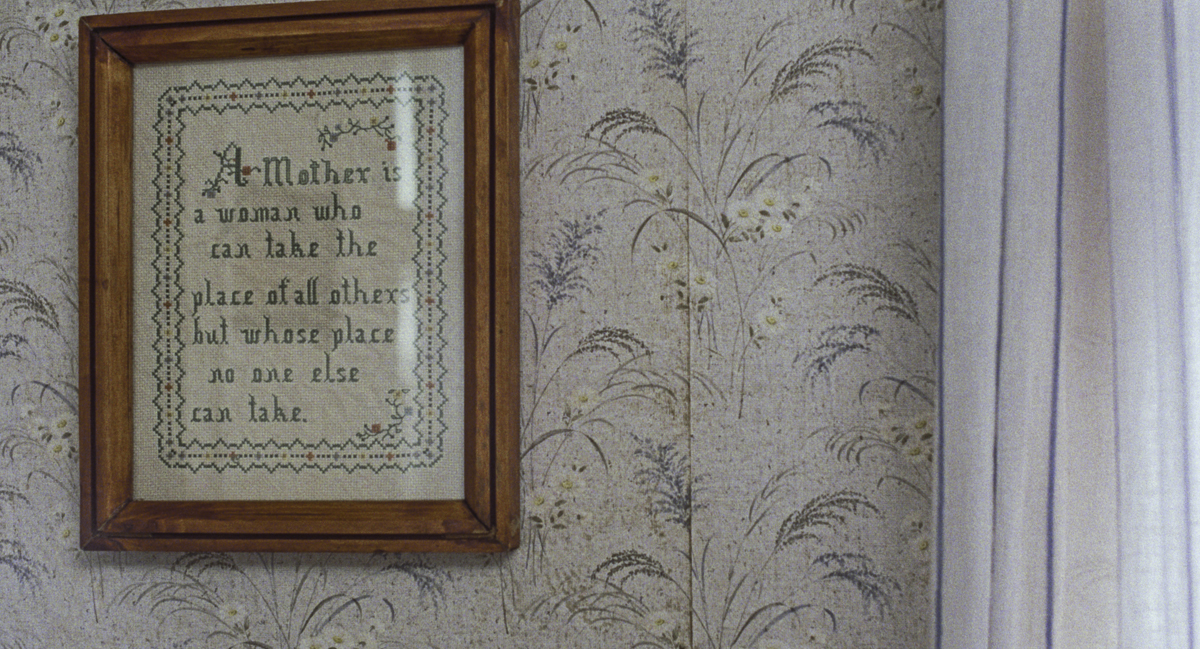
“Show ! Don’t tell”
- Les sorcières féministes : Contrairement à l’original, le film ne fait pas de la découverte que l’académie est gérée par des sorcières une surprise, il se permet une plutôt bonne scène de vote au début de l’acte 2 d’ailleurs montrant le coven fonctionner comme une petite communauté artistique. Difficile toutefois de ne pas faire attention à la non-utilisation de ses sorcières (un casting d’anciennes stars des films allemands des 70’s) en dehors de madame Blanc/Tilda Swinton et le fait qu’aussi progressiste soit-elle dans leurs propos, ça reste des harpies qui aiment massacrer des jeunes filles. Pour l’émancipation on repassera après le contrôle mental.
- La musique : La première bande originale de Thom Yorke (Radiohead), mélodique et instrumentale, presque aérienne, est (très) loin du rock progressif de Goblin, et si le grand thème “Volk” est mémorable, le reste ne s’impose jamais sur les images. De toute façon la folie est plus mesurée ici que dans la version d’Argento, par contre la chanson en soi pas mauvaise “Suspirium” n’a juste rien à foutre sur la scène finale. On n’est pas sur du décalage intéressant, on fonce en plein hors sujet.

Il a eu pas moins de 33 affiches pour ce Suspiria, et ils ont choisi celle qui est le plus dans l’esprit du film d’Argento.
- Les meurtres, la danse : L’idée de faire du déchaînement physique qu’implique la danse contemporaine (contre la danse classique de l’original) une façon de lancer de mortels sortilèges est bonne, même si ces séquences sont peu nombreuses, on passe une partie non négligeable du film à voir un vieux prof lire dans un jardin, soyons clair. Toutefois, cette année est sorti Climax et ses dantesques plans-séquences. Et Climax fait un bien meilleur Suspiria moderne que ne l’est ce remake. Il y a un cruel gouffre entre le génie de Noé et le talent raisonnable d’un Guadagnino, le machin final avec les strings ficelle rouge n’étant pas non plus le pinacle de l’originalité. Reste que les meurtres sont graphiques, soyez averti, le fan d’horreur en sera d’ailleurs peut être plus satisfait que des délires hallucinés d’il y a 40 ans. Toutefois le grand écart du réalisme au surnaturel dessert une énième fois le propos, dommage aussi que l’acmé soit la seule qui ose tutoyer le Giallo et foute un filtre rouge, mais elle se résume malheureusement à un navrant nanar gore comme l’Allemagne en faisait dans les années 90, et encore avec beaucoup de honte. Guadagnino offre un terrible spectacle où un truc confidentiel à la Burning Moon rencontre la shaky cam pourrie d’un court métrage étudiant dans une cave abritant une rave party moldave et dix pauvres filles encore à faire la toupie à 4h du matin avec au milieu Dakota Johnson sortie pompette d’une taverne bavaroise, fringuée comme vampirella, qui découvre qu’elle peut tuer en faisant la bise. Ça aurait pu être fun, c’est juste tellement poussif et mal fait que ça en devient inintéressant, et les trois touches d’humour qui suivent sont autant de coups de pioches dans ce massacre.
En bref …
Le film de Luca Guadagnino laisse une impression de malaise, mais absolument pas celle que l’on était venu chercher, on est gêné par son exercice de style boursouflé qui s’écroule rapidement sur lui-même. Il a accouché de l’équivalent cinéma du silence qui suivrait l’initiative d’un acteur plutôt médiocre dans une troupe d’excellent comédien décidant d’improviser un long monologue bancal en fin de représentation, attendant désespérément des applaudissements qui ne viendront pas sauf peut-être de l’allumé dans le fond qui trouvera la performance furieusement postmoderne. Vous aimez Suspiria ? Explorez le reste d’Argento ou regardez Néon Démon, Lords of Salem, Zulawsky, Noé, l’excellent Hérédité d’Ari Aster, découvrez Mario Bava ou même le cinéma Giallo assumé d’Hélène Cattet et Bruno Forzani et pourquoi pas le loin d’être parfait Silent Hill de Christopher Gans qui a le mérite de faire de l’horreur trash sur une relation mère-fille pas piquée des hannetons…

Le projet de remake de Suspiria était depuis 10 ans dans les cartons d’Hollywood, il a d’abord été proposé à David Gordon Green (qui s’est rabattu sur Halloween) avec Natalie Portman post-Black Swan et Isabelle Huppert. Enfin j’espère qu’ils ont aussi abandonné l’idée évoquée un temps d’en faire une série TV ou un prequel, vu le four que Suspiria est en train de faire, ça devrait aller.
Suspiria 2018 considéré isolément est un film d’horreur volontaire mais fumeux qui se noie dans le trop-plein de thèmes qu’il essaye d’aborder, décidément pas aidé par une héroïne trop parfaite qui passe de nouvelle à danseuse étoile en 48h pour finir Dumbledore cosmique à tentacule. Les amateurs de bizarreries pas trop cinévores du bizarre pourraient apprécier ce changement de voie du réalisateur accompagné de tout ce qu’il essaye mais ne mène pas à bout, d’autant plus qu’ils seront peu nombreux et pourront profiter de la joie subtile et un brin sentencieuse de défendre un film « clivant » qu’ils pensent avoir mieux compris que le reste.
Suspiria considéré en tant que remake est juste une blague de toto trop longue.
